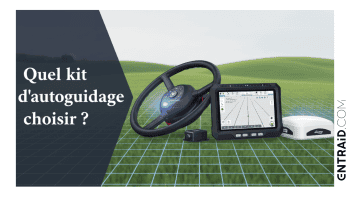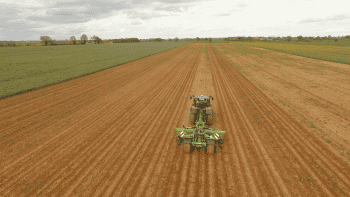Hier dans les filières d’élevage, aujourd’hui en grandes cultures et en viticulture, les difficultés se succèdent. Chacune se répercute chez les fabricants d’agroéquipements et les distributeurs. Et cela peut avoir des conséquences en termes de créances laissées chez eux, ainsi que sur les pièces et le SAV. Tout dépend de la stratégie adoptée par le fournisseur. Surtout s’il décide de s’en remettre au tribunal de commerce pour une procédure tel le redressement judiciaire agricole.
Des entreprises de fabrication et de distribution en redressement judiciaire agricole
Par le passé, on se souvient des constructeurs Delaplace, Jean de Bru, Borchard, Gilibert, ou encore Deguillaume placés en liquidation judiciaire. D’autres, tel Pichon, sont passés par la case redressement judiciaire et s’en sont sortis. C’est aujourd’hui le cas de Carré et de Naïo Technologies, apprend-on ce 18 juin 2025.
Axema, le syndicat des constructeurs de machines agricoles, alerte depuis cet hiver sur une petite dizaine de ses adhérents en difficulté. Dès lors, comment réagir en tant que client ? Si l’on veut ou que l’on doit continuer de travailler avec un fournisseur engagé dans une procédure, comment le savoir et que faire ?
Si la plupart des sociétés prévoient les temps difficiles, certaines subissent plus les soubresauts économiques. Celles-là peuvent alors avoir le bon réflexe de la procédure collective au Tribunal de commerce. L’objectif est de créer des chances de s’en sortir. En tant que client, il faut veiller à garder un œil attentif sur la santé financière de ses distributeurs ou des industriels. Il est souvent toujours possible de continuer à travailler avec eux. Mais en connaissance de cause. Car un jugement de tribunal de commerce acte sur la sauvegarde, le redressement judiciaire, voire la liquidation judiciaire. Les risques pour le client ne sont pas tout à fait les mêmes à chacun de ces stades.
La recherche du créancier souvent aussi difficile que la déclaration de créance
Pour vérifier la santé financière d’un fournisseur, il y a Google. Mais il y a aussi « le Bodacc », signale Claire Delemotte, juriste de la fédération nationale des cuma. « C’est le seul outil de veille officiel qui existe pour vérifier par exemple si un jugement a acté l’ouverture d’une procédure de sauvegarde d’une entreprise ». Service officiel du gouvernement, le Bodacc (Bulletin Officiel des Annnonces Civiles et Commerciales) est donc votre ami. Au travers d’une recherche dans la catégorie « procédures collectives » des annonces commerciales, le site peut indiquer le cas échéant qu’une déclaration de créance peut être adressée au mandataire judiciaire d’une société engagée dans une procédure.
Si tel est le cas, la période valide pour se signaler comme créancier n’est que de deux mois à compter de la publication au Bodacc du jugement qui ouvre la procédure collective. Un site web donc bien utile. Car dans bien des cas, malgré l’obligation d’envoyer une lettre au client, les mandataires rencontrent parfois des difficultés pour retrouver tous les créanciers – sachant que c’est au débiteur de remettre au mandataire la liste de ses créanciers. Cela alors que cette déclaration de créance est obligatoire à tous les stades, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
La sauvegarde, une procédure collective sous-utilisée
Premier échelon dans la procédure collective, la procédure de sauvegarde intervient avant l’état de cessation de paiement d’une entreprise. Lorsque les difficultés ne sont pas encore trop “graves ». Que l’entreprise soit un distributeur de machines agricoles ou toute autre société. Car le droit des procédures collectives est unique. Il s’applique donc de la même manière aux Cuma et à ses adhérents, par exemple.
Le plan de sauvegarde est pensé par le législateur comme un outil donnant un délai à l’entreprise pour se refaire. Il lui laisse une chance à en lui laissant gagner un peu de temps. Ce temps est toujours différent d’une entreprise à une autre, en fonction des difficultés rencontrées et de sa gestion. La sauvegarde est donc déclenchée quand l’actif disponible est encore au-dessus du passif exigible. À défaut, on peut entrer en cessation de paiement. Et on bascule alors en redressement judiciaire. Un statut plus courant.
La sauvegarde permet la continuité de l’activité, l’assurance de services et par exemple la disponibilité en pièces et SAV. À ce stade, le client n’a pas trop de soucis à se faire. Nombre de sociétés en sauvegarde ont rebondi.
Le redressement judiciaire agricole, une chance de se remettre d’aplomb
« La sauvegarde n’est pas la procédure la plus utilisée, détaille Claire Delemotte. Car les entreprises mettent souvent du temps pour voir ce qui se passe. Et l’entreprise se trouve déjà en cessation des paiements. En principe, le jugement d’ouverture du redressement intervient 45 jours après la date de cessation de paiement. L’état de cessation des paiements intervient lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au « passif exigible » (ses dettes) avec son « actif disponible » (l’ensemble de ses disponibilités) : les difficultés financières de l’entreprise sont ici avérées. Mais dans les faits, la plupart du temps, la cessation est actée depuis bien plus longtemps », observe la juriste.
Mais la situation n’est pas du tout désespérée. « Il y a toujours des chances de redresser la situation ».
Ce qui change pour l’entreprise en redressement, c’est qu’elle a un peu moins de pouvoir de gestion et de décision qu’en plan de sauvegarde. Le mandataire met de l’ordre dans les affaires. Il peut mettre fin à des contrats et en garder d’autres. « En effet, la résiliation d’un contrat peut être prononcée par le juge, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Le mandataire judiciaire peut ainsi obliger la société cocontractante à fournir le service promis. « On parle alors du principe du maintien du contrat en cours ».
Et comme pour la sauvegarde, une déclaration de créance doit être réalisée. Mais seulement si la créance est apparue entre la sauvegarde et le redressement. Comme pour la sauvegarde, il est tout à fait possible de continuer de travailler avec un fournisseur placé en redressement. Le risque est simplement plus élevé de ne pas voir le service rendu, de ne plus avoir accès à un moment donné au SAV ou de ne plus disposer de pièce localement, ou tout court s’il s’agit de l’unique fabricant.
La liquidation donne moins d’espoir
« Ça va bien plus loin encore que le redressement, prévient Claire Delemotte. Car cela veut dire que l’entreprise est en état de cessation de paiement et aussi qu’aucun redressement n’est possible. La situation est irrémédiablement compromise et signe la fin de l’activité ». Là encore, une période de déclaration de créance est ouverte. Mais seulement si la créance est née entre le redressement et la liquidation.
Avec la liquidation, le gérant de la société n’a plus de pouvoir. « Il y a dépossession : le tribunal désigne un liquidateur qui procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Dès l’ouverture de la procédure, le liquidateur assure complètement la gestion de l’entreprise. Avec ce liquidateur peuvent être actées la vente d’actifs, des licenciements, le paiement des dettes et la cessation d’activité ». Une clôture pour insuffisance d’actif peut être prononcée quand la vente des actifs n’a pas permis de payer les créances et de désintéresser tous les créanciers. Une cession partielle ou totale de la de société reste possible avec la reprise éventuelle des dettes.
Côté client, outre la gestion de la créance et de sa déclaration, aucun service n’est garanti.
Priorité à certains créanciers
À propos des créances, il faut avoir en tête qu’il y a une hiérarchie légale dans le remboursement des créanciers. Autrement dit, il s’agit donc de l’ordre selon lequel seront payés les créanciers à la fin de la procédure. Le paiement des salaires est la priorité. Suivent les frais de justice, bancaires, l’État et les organismes sociaux, puis les créanciers « postérieurs privilégiés », ceux qui disposent de sûretés (hypothèque, droit de gage, ceux avec une clause de réserve de propriété…), puis ceux qui sont intervenus pour aider et continuer de faire affaire avec l’entreprise malgré ses difficultés financières au moment de la procédure, etc.
En fin de tableau, les créanciers « chirographaires ». Ceux-là, en dernier maillon, sont par exemple les simples clients qui ont contractualisé avec l’entreprise avant l’ouverture de la procédure. Ils ne disposent d’aucun privilège et ont peu de chances de revoir leur argent. Déplumés.
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :