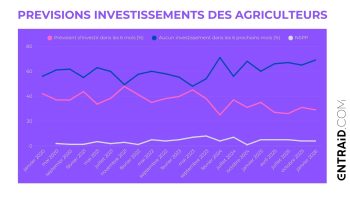Six filières ont été passées au crible par l’Inrae à l’occasion de leur étude sur les alternatives aux néonicotinoïdes dans l’agriculture En effet, l’institut de recherche agronomique a été saisi par le ministère de l’Agriculture pour déterminer les potentielles alternatives à ce type d’insecticide. Et ce, pour la culture de la betterave, des noisettes, des cerises, des pommes et dans une moindre mesure, des navets et figues. Un rapport a été remis le 28 octobre 2025. La conclusion appelle à une nécessité de donner du temps aux filières pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes.
Alternatives aux néonicotinoïdes dans l’agriculture, besoin de temps
Face à l’interdiction d’utiliser les néonicotinoïdes, « ce groupe d’experts a regardé dans chacune des filières quels étaient les dégâts engendrés et quelles étaient les solutions mobilisables aujourd’hui par les producteurs, explique Philippe Mauguin, président-directeur général de l’Inrae. Mais aussi comment les alternatives, notamment non chimiques, pouvaient se déployer ? »
Pour la betterave par exemple, culture touchée par la jaunisse, des solutions existent. Si cette infestation est très aléatoire, elle peut être dévastatrice, comme en 2020, où la production en avait sacrément pâti, estimée à – 30 %.
Toutefois, « les alternatives non chimiques nécessitent l’appropriation par les agriculteurs dans leur manière de les utiliser, estime Christian Lannou, coordinateur de la mission. Mais ce sont des solutions à effet partiel, il va faut travailler sur des approches combinatoires et développer des références techniques. Et ainsi associer ces différentes solutions à la fois à l’échelle de la parcelle à une approche territoriale. En combinant tout ça, on peut abaisser le risque de manière très importante. »
Lutte territoriale
Les betteraviers ont déjà une palette d’outils pour lutter contre les pucerons, mais leur efficacité reste limitée selon les experts. À l’image des biocontrôles. « Ils ont été développés dans le cadre du plan national de recherche et d’innovation sur la betterave, explique Christian Lannou. Parmi eux, une solution consiste à introduire des insectes prédateurs de ces pucerons qui peuvent être utilisés en lutte biologique. » Il y a également l’implantation de plantes compagnes. Celles-ci vont repousser ou perturber les pucerons dans leur repérage de la betterave. Les agriculteurs ont également la possibilité d’appliquer des solutions à base de phéromones pour induire en erreur les pucerons .
Mais en premier lieu, l’expert insiste sur le développement de la prophylaxie. « C’est de cette manière qu’on réduit le plus massivement l’incidence », précise-t-il. Cela passe par la suppression efficace des résidus de récolte. Un levier efficace qu’actionneraient peu les betteraviers. Mais aussi la répartition territoriale des betteraves porte-graines et celles destinées à la production de sucre. D’autres alternatives doivent encore voir le jour avec notamment une gamme de variétés résistantes ou des stratégies assurantielles.
La noisette, la grande perdante ?
Pour rendre toutes ces solutions efficaces, « la filière a besoin d’une épidémio surveillance solide et fiable, reconnaît l’expert. Afin de bien positionner les traitements et bien évaluer le risque. En attendant que tout ça soit opérationnel, les betteraves sont protégées par deux produits qui sont bien connus, Movento et Tepeki. Ceux-ci restent pour le moment nécessaire à la protection de la betterave. »
L’autre filière, symbole de l’utilisation de néonicotinoïdes, est celle de la noisette. Elle reste moins représentative que la betterave, mais représente tout de même 18 500 ha et 10 000 tonnes de fruits produits chaque année. C’est, cependant, celle qui souffre le plus avec des situations très critiques. Avec notamment une réelle baisse de la production ces dernières années, faute d’alternative.
La noisette doit faire face à deux ravageurs. L’un, pour tenter de l’éradiquer cette année par exemple, a nécessité 15 traitements avec six produits différents. Bien sûr, la lutte biologique n’est pas oubliée dans cette recherche d’alternatives, mais, « ces solutions ne sont pas encore disponibles, elles pourraient l’être dans un horizon de 3 à 5 ans », souligne Laure Mamy, chercheuse en ecotoxicologie.
Alternatives aux néonicotinoïdes dans l’agriculture : de la visibilité nécessaire
Pour chacune des productions étudiées, des alternatives aux néonicotinoïdes ont bien été identifiées par les experts. Mais le rapport le rappelle, les filières ont besoin d’un peu de temps pour se les approprier afin qu’elles soient pleinement efficaces.
En attendant, « il y a encore des produits, des molécules autorisées, rappelle Philippe Mauguin. Beaucoup de ces filières utilisent des molécules avec des dérogations. En début d’année 2025, les producteurs ne peuvent pas savoir s’ils vont avoir ou non la dérogation pour tel ou tel produit. Ce qui amène les experts à dire qu’il serait bien, dans la mesure du possible, de donner de la visibilité aux professionnels, que ce soit négatif ou pas. »
Suite à la remise de ce rapport, le cabinet de la ministre de l’Agriculture a assuré « en prendre connaissance et étudie avec attention les recommandations qui y figurent. » De son côté, la confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) a salué le travail réalisé par les experts. « Leur travail vient pleinement confirmer l’analyse de la CGB sur l’impasse technique dans laquelle se trouvent les betteraviers face à la jaunisse », martèle Franck Sander, président de la CGB.
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :