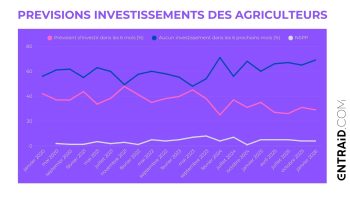Thierry Pouch, responsable du Service études économiques et prospectives des Chambres d’agriculture de France, et chercheur au Laboratoire Regards de l’Université de Reims Champagne Ardenne, analyse pour Entraid Médias les derniers développements sur les tarifs douaniers américains et chinois. Ainsi que leurs impacts sur les secteurs agricoles français et européen.
Quels sont les nouveaux droits de douane américains, et leurs conséquences l’export agricole français ?
Après des négociations tendues en Écosse, les droits de douane initialement envisagés à 30% par les États-Unis ont été ramenés à 15% pour les exportations européennes. Ils restent à 30% pour l’acier et l’aluminium. En contrepartie, l’Union européenne importera des produits américains sans droits de douane, y compris pour les engrais, ce qui est assez paradoxal.
Pour les filières françaises, la viticulture est la plus exposée. Elle représente 4 milliards d’euros d’exportations annuelles vers les États-Unis. Les produits de la boulangerie (800 millions d’excédents annuels) et certains produits laitiers sont également touchés.
Alors que certains droits de douane étaient déjà proches de 14,8% (produits laitiers), d’autres, comme pour les produits alimentaires (vins et spiritueux inclus) qui étaient autour de 11,8-12%, verront une augmentation assez significative avec ces 15%. La filière viticole et spiritueux estime des pertes de chiffre d’affaires entre 800 millions et 1 milliard d’euros par an, avec des entreprises qui commencent déjà à licencier.
Le commerce extérieur français des produits agricoles et alimentaires est d’ailleurs en déficit depuis trois mois sur les six premiers mois de 2025. Et les exportations de spiritueux ont chuté de 20%. À cela s’ajoute un euro très fort, qui a gagné près de 13-14% depuis le début de l’année. Cumulé aux droits de douane, cela représente 28% pour des exportateurs. Cela devient compliqué à ce niveau.
Les importations américaines de produits européens sont également renchéries par ces droits de douane. Mais aussi par un manque de produits de substitution. Ce qui pourrait impacter les consommateurs américains moins aisés.
La Chine répond également. Qu’est-ce qui se profile ?
La Chine a riposté aux taxes européennes sur les voitures électriques. Ce en imposant ses propres droits de douane sur des produits agricoles européens.
Les exportations de porc sont directement visées, avec des droits de douane. Ils vont de 15% pour l’Espagne à 30% pour le Danemark et 20% pour la France. Les 115 000 tonnes de porc exportées annuellement de la France vers la Chine sont menacées. Ces droits de douane, même provisoires, sont problématiques. Notamment pour des morceaux de viande peu consommés en Europe (pieds, queues, oreilles) et très prisés en Chine.
Le risque est un afflux de viande porcine des pays exportateurs vers le marché intracommunautaire. Ce qui va certainement entraîner une baisse des prix en Europe, alors qu’ils étaient plutôt corrects ces derniers temps. La Chine a également « mis en examen » les produits laitiers et le cognac.
Tarifs douaniers américains et chinois : comment l’Union européenne et la France font-elles face à cette double pression ?
L’Europe se retrouve « prise en étau » entre les deux blocs de puissance que sont les États-Unis et la Chine actuellement. Face à cela, elle tente de diversifier en multipliant ou en accélérant l’application de partenariats commerciaux. Comme elle l’a fait récemment avec le Mercosur.
Cependant, la question agricole dans l’Union européenne cristallise toutes ses propres contradictions. Il y a peu d’espoir que les États-membres puissent converger pour refaire de l’agriculture un secteur prioritaire. La PAC et le cadre financier pluriannuel montrent plutôt une réduction des soutiens.
Un paradoxe notable concerne les engrais. L’UE taxe les engrais russes, mais importe des engrais américains avec des droits nuls pour garantir l’approvisionnement des agriculteurs. Alors que leurs propres exportations sont taxées par les États-Unis. C’est complètement asymétrique.
Quelles conséquences concrètes pour les exploitations agricoles ?
Pour les exploitations, l’impact est clair : pour ceux qui n’ont pas de marge de manœuvre, ne peuvent pas rogner sur leur marge à l’exportation, il y aura du licenciement. Pour les viticulteurs, la fermeture ou le ralentissement d’entreprises de transformation signifie la fermeture de débouchés.
La stratégie agricole française, historiquement basée sur l’exportation de vins, spiritueux et céréales, doit être redéfinie face à la fragmentation de l’économie mondiale. Il faut trouver de nouveaux partenaires, et élaborer une nouvelle stratégie de conquête de débouchés. Par exemple, avec la démographie et les changements alimentaires, la demande mondiale de produits laitiers devrait exploser d’ici à 15-20 ans. Ce qui pourrait être une opportunité.
Un viticulteur pourrait envisager de diversifier sa production (sans alcool, pétillant) ou même se reconvertir. Toutefois, cette dernière option n’est pas simple, car les terres viticoles ne sont pas toujours adaptées à d’autres cultures.
Concernant l’élevage laitier, malgré une demande mondiale croissante due à la démographie et l’évolution des niveaux de vie, la filière est confrontée à des contradictions. Le renouvellement des éleveurs est difficile. Le secteur est de moins en moins soutenu par la PAC, et il fait face à des concurrents colossaux (Nouvelle-Zélande, Allemagne, Pays-Bas, Irlande). De plus, une certaine pression sociétale s’oppose à relancer l’« élevage intensif », avec toutes les nuances qu’appelle ce terme en France, ce qui crée des contradictions terribles.
Face à ce cocktail assez explosif de tensions commerciales, de taux de change défavorable et de manque de solidarité interne, il est impératif pour l’agriculture française et européenne de se poser et réfléchir activement à la suite.
Pour plus d’information, retrouvez aussi ces articles sur www.entraid.com :